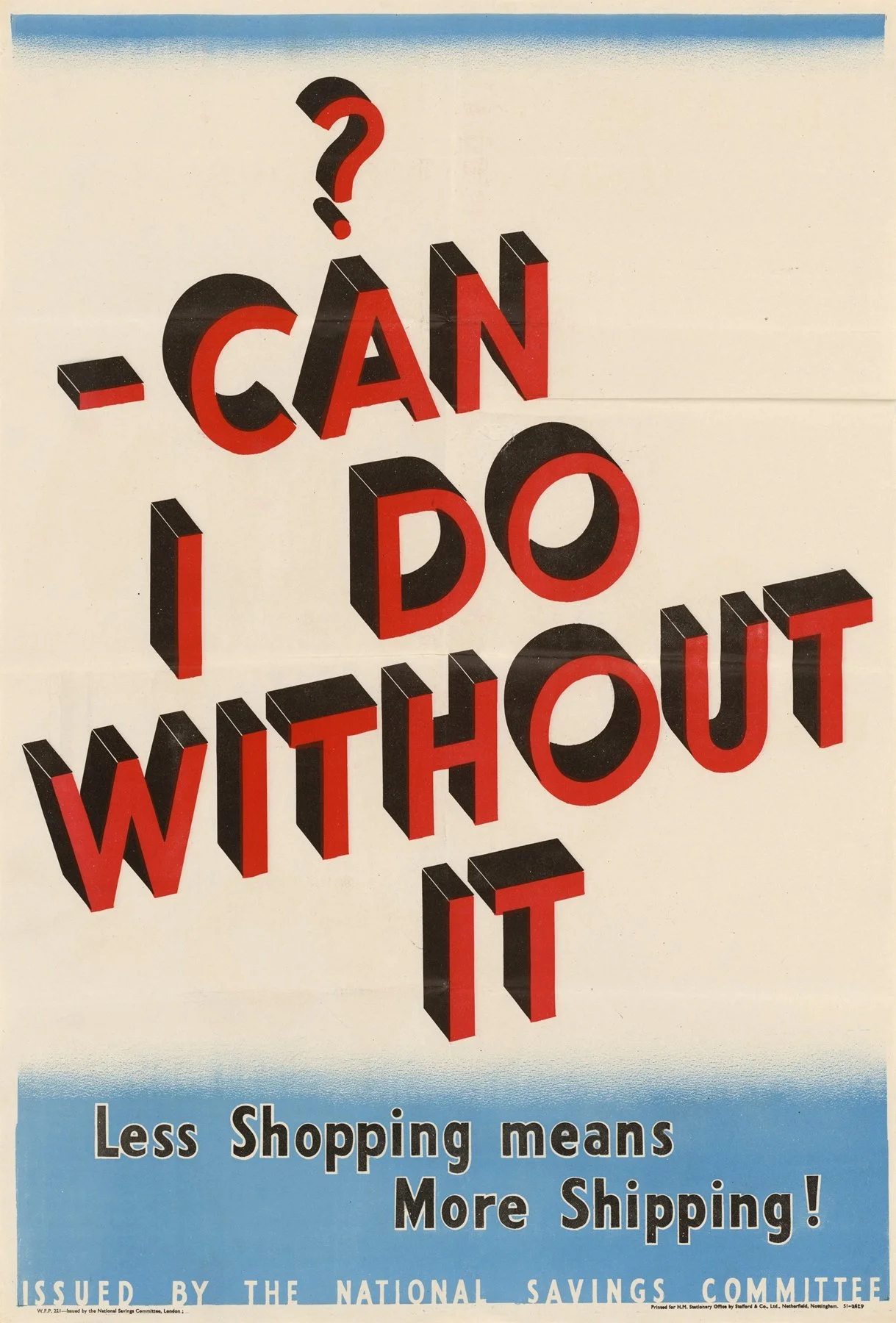Pourquoi un achat impulsif ne résout pas les problèmes psychologiques
Qui n’a jamais cliqué sur “Ajouter au panier” après une mauvaise journée ? Tu n’es pas seul. Selon une méta-analyse publiée dans le Journal of the Academy of Marketing Science (Iyer et al., 2020), près de 84 % des consommateurs déclarent céder régulièrement à des achats impulsifs. En ligne, on estime que ces décisions spontanées représentent jusqu’à 40 % des dépenses totales. En moyenne, un adulte dépenserait chaque année plus de 5 000 $ (4300 €) en achats non planifiés.
Ces chiffres montrent à quel point l’impulsion d’achat est devenue une composante presque ordinaire de nos vies; un réflexe émotionnel, souvent alimenté par la fatigue, le stress ou la recherche d’un réconfort immédiat. Mais derrière cet acte banal se cache un mécanisme psychologique bien plus profond.
Qu’est-ce qu’un achat impulsif ? (et en quoi il diffère du compulsif)
L’achat impulsif se définit comme une décision d’achat non planifiée, prise sous l’effet d’une émotion ou d’un stimulus immédiat. Il s’agit d’une envie soudaine et intense d’obtenir un produit, souvent déclenchée par une image, une promotion, ou simplement par l’humeur du moment.
Il est important de ne pas le confondre avec l’achat compulsif, qui, lui, relève d’un trouble du contrôle des impulsions. L’achat compulsif est répétitif, incontrôlable, et vise avant tout à soulager un mal-être profond (anxiété, vide intérieur, dépression). Là où l’achat impulsif reste occasionnel et généralement sans conséquences graves, le compulsif devient une stratégie d’adaptation pathologique, accompagnée de culpabilité et de perte de contrôle.
Tous les achats impulsifs ne se ressemblent pas. Le chercheur Hawkins Stern distinguait déjà quatre formes d’impulsion :
L’impulsion pure : un vrai “coup de tête”, sans lien avec les habitudes ou besoins réels.
L’impulsion de rappel : déclenchée par la vue d’un produit qui rappelle un besoin oublié (“Ah oui, j’avais presque plus de café !”).
L’impulsion de suggestion : le produit paraît soudain utile ou désirable alors qu’il n’était pas envisagé (“Tiens, cette lampe serait parfaite sur mon bureau…”).
L’impulsion planifiée : l’achat est prévu “si une bonne affaire se présente” — typique des soldes ou des ventes flash.
Autrement dit, l’achat impulsif ne naît pas toujours du vide : parfois, il s’appuie sur un besoin latent ou un simple signal contextuel. Mais dans tous les cas, il a en commun la rapidité et l’émotion.
Ce que la psychologie du consommateur nous apprend
Plusieurs modèles issus de la recherche permettent de comprendre pourquoi nous cédons à l’achat impulsif.
Le modèle EKB (Engel–Kollat–Blackwell)
Ce modèle décrit le processus d’achat rationnel : identification d’un besoin → recherche d’informations → comparaison → décision.
Lors d’un achat impulsif, ce processus est court-circuité. Il n’y a ni réflexion, ni comparaison : l’émotion prime. L’environnement (musique, odeurs, ambiance, interface web) agit comme un déclencheur immédiat qui pousse à la décision.
La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991)
Selon cette théorie, nos comportements dépendent de trois éléments :
nos attitudes (par ex. “acheter me fait du bien”) ;
les normes sociales (“tout le monde se fait plaisir, pourquoi pas moi ?”) ;
et le contrôle perçu (“je sais que je devrais me retenir, mais tant pis”).
Quand l’attitude est hédoniste et le contrôle faible, la porte est grande ouverte à l’achat impulsif.
Le modèle à double système (Dual Process Theory)
Nos décisions proviennent de deux “systèmes” :
Système 1, rapide, instinctif, émotionnel.
Système 2, lent, analytique, rationnel.
L’achat impulsif se produit quand le système 1 prend le dessus : le cerveau émotionnel agit avant que la raison ne s’exprime.
En e-commerce, tout est conçu pour activer ce système : “il ne reste plus que 2 articles !”, “livraison gratuite pendant 1 h !”, “payer en un clic”.
Les modèles de régulation émotionnelle
Enfin, certaines études (Verplanken et al., 2005 ; Hausman, 2000) montrent que l’achat impulsif sert parfois de stratégie de coping : un moyen de réguler une émotion négative.
Acheter devient alors un moyen de se distraire, de se récompenser, ou de se sentir vivant. C’est une micro-réparation émotionnelle, comparable à la façon dont on grignote ou scrolle sans fin pour éviter le vide ou l’ennui.
L’achat impulsif comme stratégie de régulation émotionnelle
Dans bien des cas, l’achat impulsif joue le rôle d’un calmant émotionnel.
Face à la solitude, au stress, ou à la frustration, le cerveau cherche un soulagement rapide. L’acte d’achat déclenche alors une libération de dopamine — l’hormone de la récompense — qui procure un sentiment de contrôle et de plaisir immédiat.
Mais ce plaisir est éphémère. Très vite, la satisfaction retombe et laisse place à une forme de vide. Ce cycle “tension → achat → soulagement → culpabilité → tension” peut devenir un cercle vicieux où l’achat n’est plus un choix, mais une fuite émotionnelle.
Les personnes sujettes à ce schéma décrivent souvent un même processus :
“Sur le moment, j’ai l’impression que ça va m’aider. Et juste après, je me sens encore plus mal.”
C’est ici que la frontière entre impulsion ordinaire et compulsion commence à s’effacer.
Quand “se faire plaisir” devient “se fuir”
“Se faire plaisir” est une expression souvent utilisée pour justifier un achat impulsif. En réalité, il s’agit parfois d’une manière détournée d’éviter une émotion inconfortable : l’ennui, la tristesse, le sentiment d’inutilité, ou simplement la fatigue mentale.
L’achat impulsif peut alors devenir une stratégie d’évitement :
Éviter le vide : remplir symboliquement un manque intérieur par la possession d’un objet.
Éviter la confrontation : détourner son attention d’un problème personnel ou relationnel.
Éviter la frustration : se redonner du pouvoir par l’acte d’achat (“au moins là, je décide”).
Mais le soulagement ne dure pas. Les émotions non traitées reviennent, amplifiées par la culpabilité ou la honte : “Je dépense trop”, “Je me sens faible”, “Je ne comprends pas pourquoi j’ai encore craqué”.
Ces pensées entretiennent le sentiment de mal-être — et donc, paradoxalement, préparent le terrain pour le prochain achat impulsif.
Sortir du cycle grâce à la psychologie
Se libérer du cycle de l’achat impulsif ne signifie pas bannir toute spontanéité. Il s’agit plutôt d’apprendre à reconnaître le besoin émotionnel caché derrière le geste.
Voici quelques pistes efficaces :
-
Noter le contexte, l’émotion ou la pensée juste avant l’achat. Était-ce de la solitude, de la colère, de la fatigue ?
-
Différer toute envie d’achat non planifiée d’une journée. Si l’envie persiste, elle sera plus consciente.
-
Respirer, marcher, appeler un proche, écrire. Ces actions calment aussi le stress sans conséquence financière.
-
Plus on renforce son sentiment de valeur personnelle, moins on cherche à la valider par la possession.
-
Une psychothérapie (notamment TCC ou ACT) peut aider à identifier les schémas de compensation émotionnelle et à restaurer un rapport apaisé à la consommation.
Le vrai luxe, c’est d’aller bien
L’achat impulsif n’est pas un “défaut” : c’est une réaction humaine, souvent émotionnelle, parfois bienfaisante, mais rarement neutre. Il devient problématique lorsqu’il cherche à remplacer le soin psychologique par le soulagement matériel.
Acheter ne soigne pas. Cela apaise — brièvement. Le vrai travail consiste à comprendre ce qui fait mal avant de chercher à le combler.
Le vrai luxe, ce n’est pas de posséder davantage: c’est de pouvoir se sentir bien sans rien acheter.
-
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Kollat, D. T. (1968). Consumer Behavior. Holt, Rinehart and Winston.
Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17(5), 403–426.
Iyer, G. R., Blut, M., Xiao, S. H., & Grewal, D. (2020). Impulse buying: A meta-analytic review. Journal of the Academy of Marketing Science, 48(3), 384–404.
O’Guinn, T. C., & Faber, R. J. (1989). Compulsive buying: A phenomenological exploration. Journal of Consumer Research, 16(2), 147–157.
Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14(2), 189–199.
Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today. Journal of Marketing, 26(2), 59–62.
Strack, F., & Deutsch, R. (2006). Reflective and impulsive determinants of consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 16(3), 205–216.
Verplanken, B., Herabadi, A., Perry, J., & Silvera, D. H. (2005). Consumers’ impulse buying tendency and impulse buying behavior. Journal of Consumer Psychology, 15(1), 1–13.